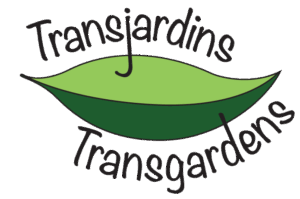Agro-foresterie, permaculture et d’autres méthodes d’agricultures existent pour répondre aux enjeux climatiques et écologique de notre époque. Dans cette section nous aborderons tous les aspects techniques de ces différentes méthodes d’agricultures durables.
- Approches durables
L’agriculture intensive développée au XXe siècle, fondée sur l’usage massif d’intrants chimiques et la rentabilité maximale des sols, a contribué à la dégradation de l’environnement et a des effets avérés sur la santé humaine. Face à ces limites, émergent aujourd’hui des formes d’agriculture plus durables, respectueuses des écosystèmes et des populations. - Parmi elles, l’agroécologie propose une gestion écologique des ressources naturelles, intégrant des pratiques telles que le compostage, les cultures associées, la réduction du labour ou encore la préservation de l’eau et des sols.
- La permaculture, quant à elle, dépasse la seule production agricole : elle repose sur un design global des systèmes de vie, où chaque élément est pensé pour interagir harmonieusement avec les autres, dans une logique d’efficacité et de durabilité.
- L’agroforesterie combine cultures, arbres et parfois animaux sur une même parcelle. Ces systèmes mixtes améliorent la biodiversité, enrichissent les sols et protègent les cultures, tout en diversifiant les sources de production.
En savoir plus… - Valorisation de la biodiversité
La biodiversité désigne la variété du vivant sur Terre, à plusieurs niveaux :
La diversité des espèces, comme la tomate, qui compte plusieurs milliers de variétés.
La diversité génétique au sein d’une même espèce (forme, couleur, taille).
La diversité des écosystèmes, tels que forêts, océans ou déserts.
Au jardin, la biodiversité est précieuse : insectes, oiseaux et petits animaux régulent les nuisibles, pollinisent les cultures et enrichissent les sols. Encourager leur présence (abris, haies, fleurs variées) aide à créer un potager plus sain et résilient.
Des plantes utiles et pleines de vie
Les plantes à parfum, aromatiques et médicinales, déjà présentes dans les jardins médiévaux au VIIème siècle, sont précieuses pour la cuisine, la santé et la biodiversité.
Les plantes à parfum (lavande, camomille, géranium rosat) sont utilisées en parfumerie, cosmétique ou cuisine.
Les aromatiques (menthe, thym, origan, romarin…) relèvent les plats et se consomment aussi en tisane.
Les médicinales (ortie, souci, guimauve, échinacée…) ont des propriétés selon les parties utilisées.
Quelques plantes faciles à cultiver : capucine, mélisse, menthe, tagète, thym, lavande, sauge, ortie, souci.
Elles embellissent le jardin tout en nourrissant les pollinisateurs et la biodiversité.
En savoir plus… - Techniques de culture
- Les cultures associées.
Egalement appelé compagnonnage, cette technique consiste à associer des plantes complémentaires, qui n’ont ni les mêmes besoins, ni le même développement. Par exemple, la carotte pousse en profondeur tandis que la tomate s’élève en hauteur : elles utilisent l’espace différemment sans se gêner.
Certaines plantes peuvent aussi repousser les ravageurs. L’œillet d’Inde, par son odeur, éloigne la mouche blanche : en planter près des légumes sensibles peut protéger naturellement le potager.
Associer des plantes à cycle court (salade, radis) avec d’autres à cycle long (chou, carotte) permet également d’optimiser l’espace de culture.
Un exemple ancestral de compagnonnage est le Milpa, pratiqué en Amérique centrale : maïs, haricot grimpant et courge sont cultivés ensemble.
Exemples de cultures associées - Cultures étagées
Dans la nature, les plantes poussent à différents niveaux : arbres, arbustes, herbes… On peut s’en inspirer pour le jardin, surtout quand l’espace est limité, en cultivant en hauteur grâce à des structures comme des treillis, piquets ou même une clôture.
Exemples de cultures étagées - Culture sur butte (ou culture en lasagnes)
Dans une forêt, les plantes poussent sans intervention humaine, car le sol y est naturellement riche et fertile: c’est le humus, formé par la décomposition des matières organiques (feuilles, bois, etc.), grâce à l’action des vers, bactéries et champignons.
Il est possible de reproduire ce processus au potager en créant une butte fertile. On y alterne différentes couches (lasagnes), alternant des matières azotées et carbonées.
En savoir plus sur la culture sur butte. - Gestion de l’eau
Dans une approche agroécologique et permaculturelle, l’eau est une ressource précieuse à gérer avec soin. On favorise des systèmes qui ralentissent, captent et infiltrent l’eau dès sa chute. L’irrigation au goutte-à-goutte, le paillage, réduisent aussi la consommation d’eau.
Exemples sur les projets de Transjardins - Fertilisation du sol
Un sol fertile est un sol riche en micronutriments, source de nourriture pour les végétaux, issus de la décompositions des matières organiques. Un sol pauvre devra être enrichi au préalable avant d’y envisager une culture. Découvrez dans cette rubrique les techniques de Compost & fertilisation, la mise en place d’arbres fertilitaires sur les planches de culture, l’usage du biochar, la mise en place d’engrais vert
En savoir plus sur la fertilisation des sols. - Petit élevage associé
Associer élevage et culture vivrière est une technique couramment utilisée en agroecologie et en agroforesterie. Les arbres peuvent protéger les animaux de leur ombrage, fournir du fourrage, tandis que les animaux pourront manger les vers des fruits et éviter leur propagation, désherber le sol et fournir un compost utile au jardin.
Exemples sur les projets de Transjardins
- Les cultures associées.
- Modules de Culture
Certaines structures peuvent être mises en place dans un jardin afin d’assurer au mieux certaines fonction du jardin. Cette rubrique présente quelques modules d’agricultures mis en place dans les différents jardins pédagogiques de Transjardins, et leurs utilités.
Exemples sur les projets de Transjardins